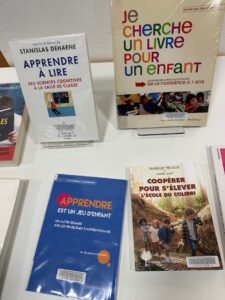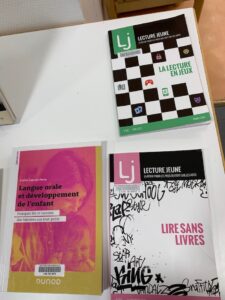« Comment les enfants peuvent-ils s’approprier la lecture ? » – Compte rendu du café-débat de septembre 2025
I
Invitées :
Eveline CHARMEUX, Agrégée de grammaire classique et moderne, Spécialiste de l’apprentissage du français et de la lecture
Auteure d’essais pédagogiques
Nadine LANNEAU, Professeure documentaliste à la retraite,
adhérente de l’Association Française pour la Lecture (AFL) – Membre du CA de Café’in, bénévole à la Médiathèque de Saint Orens (Entraînement lecture)
Toutes les deux font partie du Collectif national La Riposte Education.
***
Salle Jean Dieuzaide,
Maison des associations
42 Av. Augustin Labouilhe, Saint-Orens
***
Posons les termes du débat
Eveline Charmeux a posé la question : « Apprendre à lire ou s’approprier la lecture ? »
Ce sont deux conceptions du problème complètement opposées car si le travail se fait avec les élèves, il faut envisager soit
- qu’ils absorbent des connaissances
- soit qu’ils se transforment à partir des connaissances qu’on leur donne.
Dans la seconde conception, remarquons que les enfants sont plus actifs, s’engagent de fait, plus, que dans la première.
On peut par conséquent dire qu’alors que leurs enseignant.e.s les enseignent en général par des moyens appropriés, des méthodes pour les amener à lire, il faut, pour que tout cela fonctionne, que les enfants de leur côté, s’approprient de manière active cet enseignement d’une manière propre à chacune et à chacun. Il faut que les enfants s’y engagent de manière volontaire.
Car le savoir se construit et ce sont les enfants eux-mêmes qui construisent leur savoir.
***
L’apprentissage de la lecture hier et aujourd’hui : deux contextes, des différences
Un fait majeur : de nos jours, les écrits sont partout présents autour des élèves. Jadis non.
Jadis l’enseignant apportait de l’écrit à l’école. Il devait même le fabriquer lui-même.
Aujourd’hui on peut utiliser en classe, les écrits omniprésents partout. Les élèves sont même noyés dans ces écrits. On doit donc très tôt dès la maternelle changer d’optique par rapport à autrefois : avant de les enseigne, aider les élèves à se poser des questions sur ces écrits. Leur montrer que l’écrit est partout, que cet écrit, ils vont devoir le comprendre.
Eveline Charmeux, quand elle était formatrice en institut de formation des instituteurs et institutrices à l’IUFM de Toulouse, amenait les élèves de la classe d’application, dans la rue, découvrir les affiches de la mairie de Toulouse que l’on rencontrait partout : par exemple, les élèves étaient attirés par l’image d’un gros balai de sorcière et elle leur montrait qu’il y avait écrit : « Balayons nos habitudes ! ».
- D’où questionnement sur la signification à la fois de l’image et du texte. Plusieurs élèves interprétaient à leur manière : « Il faut avoir l’habitude de balayer ! » Effectivement, ils voyaient leur mère balayer souvent…
- Se faisait alors tout un travail sur la métaphore sans dire le mot technique. D’où un travail sur l’ordre des mots, toujours sur le sens, comment ces mots si on en changeait l’ordre pouvait changer le sens. Important pour sortir d’une première impression. On ne peut le faire avec des mots isolés, hors contexte.
- Important alors le travail sur l’orthographe de ces mots, à fixer très tôt car ces connaissances sont essentielles pour la lecture et en parallèle, pour l’écriture. Ce qui implique que la lecture soit dès le début une lecture silencieuse avec les yeux. En lisant avec les yeux, on voit les différences entre les mots et on retient leur forme.
A l’extérieur, Eveline Charmeux utilisait les affiches de la rue et dans l’école, les affichages sur les conseils de sécurité dans les couloirs par exemple.
Les enfants devant ces écrits doivent se poser des questions :
- Ces écrits, à quoi ils servent : leur fonction
- Ces écrits, comment ils fonctionnent ? Quelle est leur construction, leurs effets sur le lecteur ?
- Ces écrits, comment on peut s’en servir ?
Les enfants apprenaient ainsi à lire comme ils avaient appris à parler.
L’enfant comme un chercheur, observait, posait des hypothèses, se questionnait avec la classe, avec l’adulte, pour donner un sens.
***
Car la lecture, c’est comprendre,
c’est donner du sens à ce qu’on lit
Les programmes 2024 du Français pour la maternelle, le CP, le CE1, le CE2 : un non-sens
Eveline Charmeux s’indigne des programmes 2024 pour la maternelle, CP, CE1, CE2 qui demandent d’automatiser le déchiffrage des syllabes : une activité qui n’a aucun sens pour les élèves.
En fait, ce sont certains neuroscientifiques avec à leur tête Stanislas Dehaene qui ont, depuis le ministère de J.M. Blanquer dès 2017, imposé une nouvelle pédagogie de la lecture, prétendument innovante car scientifique. Or elle ne fait que raviver la traditionnelle syllabique et en pire, car sous le prétexte de la Science, elle impose une méthode et une seule et par conséquent, détruit la liberté pédagogique des enseignant.e.s. Stanislas Dehaene en impose donc car il a été nommé aux plus hautes fonctions, dans le Conseil Scientifique de l’Education (CSEN) organisme d’Etat constitué en 2018, dont il est le président.
Il faut savoir que tous les neuroscientifiques ne suivent pas Stanilas Dehaene et considèrent que la pédagogie n’est pas de leur ressort. La pédagogie doit rester ce qu’elle a toujours été, un art. Les neurosciences ont leur domaine d’investigation et de recherches par ailleurs.
Eveline Charmeux est totalement opposée aux dernières nouveautés en matière d’apprentissage de lecture, même si Stanislas Dehaene déclare avoir enfin découvert le Graal grâce à ses IRM, imageries cérébrales du cerveau. Tout cet arsenal neuroscientifique est en effet assorti de soit-disant « innovations » :
- Elle a donc vivement critiqué la « fluence » ou lire très vite à haute voix pour un improbable accès au sens. La lecture, une course contre la montre, il fallait y penser ! Photo en notes en bas de cette page d’une lecture de syllabes chronométrées.
- Elle a écarté la vieille querelle entre méthode globale et syllabique : « La syllabique n’a jamais disparu sous les coups de la globale qui n’a jamais été appliquée en France. L’essentiel est de faire comprendre que lire, c’est comprendre le sens de ce qu’on lit, surtout quand manquent à la maison les codes et les aides. » Savoir que l’écrit n’est pas le calque de l’oral.
Les enfants doivent partir d’écrits vrais. Or en CP les écrits sont artificiels, faits pour enseigner la lecture avec une méthode.
Les syllabes, des bouts de phrases, des mots sans liens les uns avec les autres n’ont aucun sens pour les élèves. Parmi ceux-ci, certaines et certains se rebellent, refusent car ils ont besoin de comprendre. Il leur faut un texte avec une histoire à comprendre ou des informations à découvrir. Tout le contraire d’une méthode.
Avec un texte à lire, on a une vue d’ensemble qui donne une première idée de son contenu, ce qui va faciliter la lecture, lui donner une direction, un sens.
Des exemples pour aider les enfants à comprendre
Partir d’une chanson connue des enfants « Sur le pont d’Avignon » par exemple, pour que les enfants parviennent à retrouver la signification des paroles.
Freinet utilisait les écrits des enfants eux-mêmes. Il les faisait lire à partir de ce qui pouvait les intéresser, les toucher.
Quel bilan après le primaire, au collège, en sixième et dans les classes suivantes… ?
Nadine Lanneau, la seconde intervenante du débat, professeure documentaliste à la retraite récente, a approuvé Eveline Charmeux. Forte de son expérience professionnelle, elle a déclaré qu’au collège en sixième elle voyait arriver trop d’élèves…
- qui savaient parfaitement déchiffrer,
- mais ne comprenaient pas le sens de ce qu’elles ou ils lisaient, ou bien comprenaient à moitié.
- D’autres à l’inverse, avaient déjà acquis des compétences remarquables en compréhension.
Et elle avait remarqué que dans la majeure partie des cas, le milieu social, les catégories socio-professionnelles, les fameuses CSP, avaient un rôle déterminant. Les élèves des CSP les plus défavorisées, parce qu’ils n’avaient pas chez eux les aides ni les codes faisaient partie des non-lecteurs et non-lectrices, c’est-à-dire de ceux qui ne maîtrisaient pas la véritable lecture-compréhension, empêché.e.s par un déchiffrage laborieux dont ils ne parvenaient pas à sortir. Or, la véritable lecture est absolument indispensable dans toutes les disciplines au collège, pas seulement en français, mais même en mathématiques où la compréhension des énoncés est essentielle. Elle est discriminante. Et une fois de mauvaises habitudes prises en CP jusqu’au CE1, à travers des lectures simplistes, des listes de mots, des phrases courtes, dénuées de complexité, lorsqu’en CE2 les élèves sont confrontés à des textes plus complexes, plus longs, une grande partie des élèves se décourage.
Les deux intervenantes, encouragent donc dès l’école primaire (écoute de livres en maternelle, et en élémentaire surtout en CP) la lecture de textes porteurs de sens.
***
L’organisation de l’école et des classes a son importance
D’autre part, les deux intervenantes incitent à miser sur l’entraide entre pairs, sur l’effet d’entraînement du groupe. Le public témoigne aussi de l’importance de ces dynamiques collectives : Les enfants apprennent mieux : les élèves plus grands apprennent aussi des plus petits quand dans les classes on laisse les enfants s’entraider.
Les classes uniques de campagne ont peu à peu disparu du paysage scolaire et de certains villages désertés…
Le public évoque alors les classes multi-âges comme les classes uniques : des témoignages sont donnés d’entrées en classe unique de campagne à 4 ans et demi, âge de la maternelle, d’enfants qui au contact d’élèves plus âgés, ont appris à lire presque seuls, en écoutant les plus grands, en profitant de leur aide et de celle de leur enseignant.e.
Ces classes uniques dont toutes les études ont montré les bienfaits, ont disparu ces dernières années : on préfère maintenant regrouper les enfants de plusieurs villages dans un seul village. Les enfants y sont transportés en bus scolaire. Un plus quand même par rapport aux classes qui existent en ville (une classe, un âge, un niveau…) A condition d’oublier que ces regroupement participent d’une désertification de nombreux villages en France, on peut y voir un côté positif : Ces nouvelles classes de village regroupent par nécessité ce qui peut être considéré comme les cycles préconisés depuis la loi d’orientation de 1989, des classes de trois niveaux mais jamais ou si peu appliqués en ville. La question reste posée.
***
Rôle essentiel des médiathèques, CDI, BCD
Nadine Lanneau a mis en lumière le rôle essentiel dans les apprentissages premiers et continus des bibliothèques, médiathèques, Centre de Documentation (CDI) au collège et au lycée où elle a exercé et de la BCD Bibliothèque Centre Documentaire des écoles maternelles et élémentaires lorsqu’elles fonctionnent.
Bénévole à la médiathèque depuis qu’elle est à la retraite, et dans le cadre de ses actions dans l’association Café’in de Saint Orens de Gameville (31), elle témoigne. Elle reçoit des enfants et des jeunes collégiens qui rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. Les parents sont en général désemparés. Elle leur dit qu’elle se contentera d’utiliser les ressources de la médiathèque pour amener leur enfant à changer son regard sur la lecture. Car le problème vient de là. Elle n’intervient pas sur l’enseignement donné en classe.
La médiathèque offre des documents sur tous supports, imprimés et numériques. Comme au CDI. On y choisit en fonction de ses goûts comme ce CP venu en milieu d’année pour des difficultés en déchiffrage, très rebelle par rapport à l’adulte et qui avait, de lui-même, pris un gros livre documentaire sur « Les requins », fasciné par la photo sur la page de couverture d’un énorme requin !
Utiliser la médiathèque, le CDI, la BCD pour l’apprentissage de la lecture : comment ?
En résumé : il faut faire comprendre à l’enfant qu’il faut d’abord aborder le support dans ses spécificités. Ainsi on ne lit pas un livre documentaire comme une histoire dans un roman ou une revue pas plus qu’un article de revue ou sur une page web. Entre parenthèses, c’est le travail d’explication que font les professeur.e.s documentalistes en sixième. Les enseignant.e.s de toutes disciplines au collège mais déjà en primaire peuvent le faire également. Il est important que les élèves aient conscience que des aides existent à l’intérieur des livres et des aides spécifiques selon leur nature, sans parler des pages web ou des articles de journaux qui exigent des lectures particulières.
Dans le cas de ce gros livre documentaire – et il y a eu d’autres exemples – : l’élève de CP a ainsi compris qu’il existe des aides dans les livres documentaires qui permettent d’appréhender le sens. Dans cet exemple : l’élève se trouvait sur une page, face à une image d’un gigantesque requin près d’une gigantesque baleine (mais quelle échelle ? L’image ne le montrait pas…)
Le texte de la légende a expliqué l’image :
- « Regarde, dans ce rectangle sous l’image, il y a un texte. Je le lis (regarde comment je fais, dans ma tête bien sûr, avec mes yeux) et je lis que ce n’est pas un requin de notre époque. C’est un mégalodon qui n’existe plus ! Et mégalodon signifie grande dent ! »
- – Dessous il y a deux dents, une très grande et une plus petite !
- – Voilà ! Et tu lis quoi ?
- – Il y a écrit « dent » sous les deux dents
- – Bravo ! La grande c’est celle du mégalodon et la petite, celle du requin d’aujourd’hui. »
Depuis nous avons recherché d’autres aides, les tables des matières, les index, etc. Et pour lui il est devenu normal de s’appuyer sur ces outils. Cet enfant qui vient encore avec moi en CE1 depuis la rentrée, parce qu’il a pris plaisir à venir à la médiathèque qui offre aussi des jeux de société, des expositions etc. continue d’utiliser ces aides que je montrais aux sixièmes à la rentrée mais aussi aux élèves de tous les niveaux quand nous faisions des recherches documentaires – très souvent sur des pages web –
***
Grandeur et décadence d’un outil essentiel en primaire : les BCD et le devenir de notre Ecole
Eveline Charmeux : il y a eu une période entre 68 et après où une école nouvelle s’est profilée.
Nadine Lanneau : j’ai eu une professeure de français en seconde en 1970 qui suivait les cours de Sciences de l’Education nouvellement créés et qui disait « Tous les élèves sont éducables. » Depuis, ce slogan émancipateur est passé de mode, semble-t-il.
- Une dérive lamentable : On a pris les analyses des sociologues comme Pierre Bourdieu qui montrent que les élèves de classes défavorisées ont des handicaps culturels et sociaux (et ce n’est pas nouveau, ça a toujours existé depuis Jules Ferry), pour dire que ces élèves-là ne peuvent pas s’en sortir. Or, pour les sociologues ce sont des constats qui ne déterminent pas à tout prix le devenir de ces élèves. Le problème, c’est que d’abord il y a eu ce détournement de leurs analyses qui a par voie de conséquence permis d’éviter de trouver des solutions pour transformer l’Ecole… A quoi bon ? C’est la fatalité ! Alors que d’autres études montrent les exemples positifs des systèmes scolaires à l’International !
- Et l’on connaît les dérives encore plus graves à l’heure actuelle, où les derniers ministres ne se cachent même plus pour favoriser un tri social ! Le revendiquer !
Une école nouvelle, des écoles expérimentales ont existé
Dans les années 1960-2000 dans le service public d’éducation, de nombreuses écoles expérimentales en liaison avec l’Institut national de la Recherche Pédagogique ont inventé une nouvelle école, une pédagogie différente de la lecture pour sortir du déchiffrage et un outil, les BCD Bibliothèques Centres Documentaires, lieux d’observation de tous les écrits et d’exposés par une fréquentation quotidienne. Un comité de gestion associait élèves, parents, bibliothécaires : ouverture de l’école !
- Citons dans les années 60, l’école Vitruve à Paris : elle existe encore.
- De 1970 à 2000, citons le groupe scolaire de La Villeneuve de Grenoble, avec 5 écoles primaires et un collège, au bas des immeubles d’un quartier innovant. Ce projet soutenu par des inspecteurs de l’Education nationale a disparu après 2000, l’administration de l’Education nationale n’a plus aidé.
Les suites… années 1980
Dans les années 1980, la généralisation à la fois des Bibliothèques Centres de Documentation à toutes les écoles françaises, maternelles et élémentaires (avec des envois massifs de cartons de livres) fut imposée, sans formation des maîtres. Des parents, des enseignants du secondaire, des bibliothécaires furent alors appelés à la rescousse par des équipes désorientées. D’autres équipes étaient déjà engagées dans ce projet d’une nouvelle façon d’apprendre à lire, avec une nouvelle manière de considérer le statut de l’enfant. C’étaient et ce sont toujours des équipes d’enseignant•e•s militant•e•s dans l’Education Nouvelle.
Depuis cette époque, le manque de moyens et de formation a signé le déclin de ce projet : si les BCD existent encore sur le papier, ce ne sont plus que des coquilles vides…de sens.
***
NOTES
Ces notes sont le fruit de recherches documentaires pour compléter le débat. Des commentaires sont activés en bas de page pour continuer… le débat !
A la médiathèque, dans le cadre de l’association Café’in de Saint Orens
N. Lanneau, professeure documentaliste, maintenant à la retraite, membre de l’AFL (Association Française de la lecture) depuis les années 1980, fait profiter de son expérience professionnelle :
- en proposant aux enfants à partir du CE2 (8-9 ans) et aux jeunes de collège et de lycée, un entraînement lecture sur le logiciel Elsaweb de l’AFL (Association Française pour la Lecture).
-
- Le logiciel d’entraînement à la véritable lecture, a d’abord été utilisé dans l’Education nationale à partir de 1983, dans les écoles, sous la forme d’ELMO (Entraînement à la Lecture sur MicroOrdinateur. « En 1996, le logiciel ELSA (Entraînement à la Lecture Savante) succède à ELMO pour profiter de l’ouverture et de la souplesse de l’informatique et mieux diversifier les scénarios de ses exercices et leurs bibliothèques de textes. En novembre 2015, l’Association Française pour la Lecture, mouvement pédagogique de Recherche-Action (sans but lucratif), propose un elsa sur le web. Cette plateforme – qui s’ajuste au niveau et aux difficultés de chaque utilisateur – se complète d’une partie réflexive afin de permettre à celui qui s’entraîne de revenir sur sa manière de procéder pour en prendre conscience et personnaliser ainsi ses compétences. »Sur le site de l’AFL. On peut tester le logiciel gratuitement. Ces outils sont le fruit d’un travail collaboratif entre chercheurs français et chercheurs de l’Uquam de Montréal.
-
- Les plus jeunes qui n’accèdent pas au logiciel du fait de leur jeune âge, bénéficient comme les autres, de tout l’environnement de la médiathèque et de ses animations. Rien ne vaut un lieu bien fourni en documents de toutes sortes comme celui d’une médiathèque, d’un CDI, d’une BCD quand elle fonctionne, avec l’accompagnement bienveillant des bibliothécaires, des professeur•e•s documentalistes et des professeurs de toutes disciplines en primaire (maternelle, élémentaire), collège et lycée.
- Le logiciel elsaweb permet de dépasser le déchiffrement, la lecture syllabique à haute voix (et dorénavant, avec la fluence, à toute vitesse), pour accéder à la véritable lecture, la lecture silencieuse avec les yeux, seule à même de faire comprendre ce que l’on lit et de la faire comprendre ensuite, s’il le faut à autrui.
- En effet, il n’y a que deux sortes de lecture :
- la silencieuse avec les yeux pour comprendre d’abord
- et la lecture pour communiquer à voix haute à autrui, si besoin est, dans des exposés, des oraux, des poésies, du théâtre etc.
- Ces deux sortes de lecture donc, n’ont pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes objectifs. Or beaucoup trop d’élèves ne parviennent pas à sortir des habitudes néfastes prises dès le début de leur apprentissage : c’est la lecture à voix haute qui est privilégiée – et depuis 2018, encore plus avec la fluence qui la chronomètre – pourquoi ? Parce qu’une lecture à voix haute, immédiate, – de nombreux exemples issus de l’observation sur le terrain – est un moyen de contrôle. Du sens ? Très souvent, si peu mais de la prise en compte de la succession des syllabes.
- Or, les études, et les observations montrent que beaucoup d’élèves arrivent en sixième en sachant déchiffrer, oui (lire des syllabes et maintenant de plus en plus vite avec la fluence) mais sans trop comprendre ou pas du tout ce qu’ils lisent. Or, lire c’est comprendre.
- En effet, il n’y a que deux sortes de lecture :
- Ces habitudes prises très tôt les handicaperont dans leurs études et dans leur vie en société. Bien sûr, on peut toujours se débrouiller mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? D’autre part, des élèves sortent du lot, ayant appris seuls ou parce que l’entourage familial a été aidant, médiateur, dès le début de l’apprentissage, dès la maternelle et même avant (crèches par ex.) : lectures comme des lieux de rencontre, fréquentation des bibliothèques, beaucoup de livres et de documents de toutes sortes à la maison qui permettent à l’enfant de donner du sens au mot Lecture. Toutes les études nationales comme internationales montrent que ces inégalités scolaires sont étroitement liées au milieu familial, ce qui n’est pas nouveau depuis l’origine de l’Ecole créée par Jules Ferry fin XIXème (sous la 3ème république).
***
Petit retour sur l’histoire du système éducatif depuis Jules Ferry et qui a eu une influence sur l’apprentissage de la lecture, on le verra…
Sous le gouvernement de Jules Ferry, en 1880, la III ème République, le système éducatif était à plusieurs vitesses, selon des critères de classes sociologiques. Il s’est surtout agi pour les républicains de l’époque, de se démarquer de l’emprise de l’Eglise Catholique qui détenait tous les pouvoirs. D’où la loi sur la laïcité de 1905 concrétisant la séparation des Églises (de toutes les Eglises) et de l’État.
Jules Ferry est connu comme l’auteur d’une instruction égale pour toutes et tous. Mais il y avait déjà un ordre datant de Napoléon 1er : le lycée où les familles bourgeoises envoyaient leurs garçons dès la classe de CP appelée « le petit lycée ». En général, l’apprentissage de la lecture avait commencé bien avant, dans les familles, avec un précepteurs, ou avec les parents, généralement la mère. Françoise Dolto, la psychanalyste a bien connu ce système puisqu’elle venait d’une famille bourgeoise. Mais en ce qui concerne les filles, ce ne fut pas si simple d’accéder au fameux lycée… de garçons
« Toutes les questions et les polémiques incessantes autour de la question éducative au long du XIXe siècle trouvent leurs origines dans cette période fondatrice, et sont cristallisées autour du lycée : qui pour contrôler le système éducatif ? L’État est-il légitime pour établir un monopole ? Quelle place laisser à l’Église ? Comment prendre en charge la formation des futures élites ? Quel modèle d’instruction faut-il développer pour encadrer les jeunes
A savoir : « Napoléon crée La loi 1er mai 1802 qui institue les lycées de garçons, mais elle crée aussi d’autres structures d’enseignement du second degré, en particulier les « écoles secondaires » communales appelées « collèges » à partir de 1808, ainsi que les écoles secondaires privées (appelées « institutions » ou « pensions » à partir de 1808) – la plupart seront catholiques – et les écoles diocésaines préparatoires à l’état ecclésiastique. » ? » Sur le site Napoléon.org, histoire de la Fondation Napoléon.
- Il y avait donc un enseignement secondaire avant les lois Jules Ferry
- Le lycée payant, pour les garçons de la bourgeoisie, des enfants de notables, créé par Napoléon, en 1802, pour préparer le baccalauréat et donc poursuivre de hautes études, à l’Université afin d’accéder à de hautes carrières, conformément à leur classe sociale. Ce lycée s’adressait strictement aux fils de la bourgeoisie. Les filles y sont absentes. Les garçons y entraient à l’âge du CP, sachant déjà lire, et on leurs maîtres leur proposaient des textes complexes, jamais de textes à lire avec des méthodes de lecture. Nous verrons que ces méthodes ont été inventées pour l’enseignement à la Communale, l’élémentaire.
- « Comme l’avait si justement écrit l’historien Alphonse Aulard au début du XXe siècle, les lycées napoléoniens sont « mi-supérieurs, mi-secondaires », et on remarquera, qu’encore aujourd’hui, la place du lycée dans notre système éducatif est l’objet d’interrogations puisqu’il a été précisément conçu par Napoléon Bonaparte à la fois comme une structure d’aboutissement de l’enseignement secondaire et comme un établissement préparant aux études supérieures. » Dans le même site.
- « Pour créer les lycées, Napoléon s’est largement inspiré des collèges jésuites. […] Dirigés par un proviseur, organisés par classes de niveau dans lesquelles enseigne un personnel hiérarchisé en fonction de ses titres universitaires, les lycées vont représenter le fondement de l’enseignement secondaire. » Il reste encore un modèle à la fois dans l’imaginaire français mais aussi dans la réalié, dans son organisation. L’enseignement au lycée était subordonné à l’apprentissage du latin, la clé qui ouvrait toutes les portes.
- Le lycée pour jeunes filles fut créé en 1880 par Camille See,
- Toutes les filles avaient jusque-là, un enseignement religieux, qui dépendait de l’Eglise catholique. A partir des Lois de Jules Ferry en 1880 et 1881, les filles des classes aisées obtiennent l’extension à l’enseignement secondaire d’État, le 21 décembre 1880 avec Camille See, républicain comme Ferry, député et membre du Conseil d’Etat et elles purent enfin préparer le bac comme les garçons. Mais pas la majoirité des filles de milieu moins aisé ou populaire.
- Entre parenthèses, il peut être intéressant et pas hors de notre sujet sur l’apprentissage de la lecture, qui est avant tout accès au savoir, de relire l’argumentaire de Camille Sée pour arracher le vote de ce fameux lycée de jeunes filles auprès de ses collègues masculins. On voit très nettement que les lois Jules Ferry institue deux ordres qui ne se côtoient pas : une Communale pour toutes et tous les élèves avec un savoir minimum dirons-nous et un enseignement pour l’élite donc au lycée que Camille Sée parvient à ouvrir aux filles de la bourgeoisie, un enseignement différent de celui de la communale. Ces jeunes filles bourgeoises auront de nombreuses années devant elles pour s’émanciper du discours patriarcal tenu à leur égard. Le discours de Camille Sée est complexe :
- « Tant que l’éducation des femmes finira avec l’instruction primaire, [Ndlr : les lois Jules Ferry sur l’école primaire, datent de ce moment], il sera presque impossible de vaincre les préjugés, les superstitions, la routine. Les femmes, quoi qu’on fasse, dirigent les mœurs, et c’est par les mœurs, plus encore que par les lois, que se font les peuples. »[…] « Il ne s’agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d’élever leurs enfants et de tenir leurs ménages, ni de les transformer en savants, en bas-bleus, en ergoteuses. Il s’agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a prodigués, pour les mettre en état de mieux remplir les devoirs sérieux que la nature leur a imposés. » Il compara l’enseignement secondaire des jeunes filles en France à celle de nombreux autres pays dont certains étaient en avance dans ce domaine comme les États-Unis et l’Allemagne. Et il fait notamment référence au « principe de l’égalité de l’homme et de la femme devant l’instruction. » La loi fut votée en 1880. » Wikipedia
- Le lycée payant, pour les garçons de la bourgeoisie, des enfants de notables, créé par Napoléon, en 1802, pour préparer le baccalauréat et donc poursuivre de hautes études, à l’Université afin d’accéder à de hautes carrières, conformément à leur classe sociale. Ce lycée s’adressait strictement aux fils de la bourgeoisie. Les filles y sont absentes. Les garçons y entraient à l’âge du CP, sachant déjà lire, et on leurs maîtres leur proposaient des textes complexes, jamais de textes à lire avec des méthodes de lecture. Nous verrons que ces méthodes ont été inventées pour l’enseignement à la Communale, l’élémentaire.
- Et en 1880, les lois de Jules Ferry créent l’enseignement primaire avec la Communale, destinée à tous les autres élèves.
- C’est là qu’ont été inventées les fameuses méthodes de lecture pour apprendre à lire, qui ne sont nullement de la lecture, mais de bouts de phases simplistes, loin de la complexité des textes proposés par les jésuites au lycée.
- . »Longtemps, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire n’ont pas désigné des étapes successives de la scolarité des élèves mais deux types d’enseignement et d’établissement parallèles :
-
- l’enseignement primaire supérieur, dispensé pendant quatre ans après le certificat d’études, de la sixième à la troisième. Il menait principalement aux carrières de l’administration. On y préparait le brevet élémentaire.
- l’enseignement dispensé dans les lycées de la sixième à la terminale. (NDLR : au lycée existait le CP distinct du CP de la Communale, cad l’école pour tous)
- les centres d’apprentissage et technique
-
- Cela dura jusque dans les années 60-70 : il y a eu d’abord des constats au niveau du ministère et au niveau politique qui ont dépassé les clivages politiques. C’est le général de Gaule qui donna l’impulsion et l’on eut la Réforme Berthoin en 1959 qui ne s’appliqua qu’en 1963 et qui allongea la scolarité de tous les élèves à 16 ans :
- Deux historiens universitaires témoignent : « L’allongement des scolarités de deux ans pour élever le niveau de formation et de qualification de la population française, le Général De Gaulle souhaite le développement d’une classe de techniciens et de cadres intermédiaires, est décidée dans un contexte démographique bien particulier.
- L’effectif des classes démographiques en âge d’entrer en sixième à partir de 1956 est nettement plus important que celui des années précédentes, non seulement le système éducatif doit accueillir environ 250 000 jeunes de plus en sixième, mais il doit les garder 2 ans de plus, au total il faut augmenter les capacités d’accueil de près de 2 500 000 places. En conséquence la décision prise par décret en 1959, n’entre en vigueur qu’en 1963, le temps de construire les collèges nécessaires et d’organiser le nouveau fonctionnement. En même temps, le gouvernement programme le développement de l’école maternelle avec l’objectif de scolariser progressivement tous les enfants à partir de 3 ans. » Lire sur la page du site « Un atlas des fractures scolaires en France » – Ce site est un complément à l’Atlas des fractures scolaires (Autrement, 2010) et à Education et fractures scolaires (Chronique sociale, 2022) par de nouvelles analyses des inégalités de la maternelle à l’enseignement supérieur. Sur cette page.Et en 1975… le collège unique :
- Et en 1975… le collège unique...
- La réforme du collège de 1975, réforme du collège unique, réforme Haby est une réforme de l’enseignement secondaire qui avait été voulue personnellement par le président de la République Valéry Giscard d’Estaing.
- Elle prévoit notamment la mise en place d’un « collège pour tous » (le premier cycle du secondaire) en continuité de l’« école pour tous » (le « primaire »). C’est la raison pour laquelle on parle dès lors de « collège unique ».À l’époque très contestée par la gauche, elle est ensuite accusée par la droite d’avoir entraîné un effondrement du niveau scolaire. » Wikipédia.
***
Jean-Yves Séradin, membre de l’AFL Association Française pour la lecture a écrit « Lire ou ne pas lire. Que peut l’école ? », livre en voie de publication dont il nous a fait la primeur. Il l’a dédié « Aux bibliothécaires de rue d’ATD Quart Monde », ce qui exprime bien la prise en compte par les adhérents de l’AFL, des enfants et des jeunes éloigné•e•s de la lecture du fait de leur milieu, victimes de la pauvreté, des inégalités dans la société qui se retrouvent automatiquement si rien n’est fait pour les contrecarrer… aussi à l’Ecole dès la maternelle.
Quelques extraits avec l’autorisation de l’auteur :
- J.Y. Séradin cite le livre publié par les Editions Quart Monde/Le bord de l’eau, 2024 : Il y a des témoignages d’enfants, d’élèves ou d’adultes. « Témoignage de Thierry, 55 ans, Apprendre des scolarités abîmées, Coordonné par Régis Félix.
- Il est dit sur la page du site d’ATD-QuartMonde : »Émergent […] les bases d’un projet d’école étroitement associé à un projet de société : une école qui n’oublie personne pour une société qui n’oublie personne, c’est la clé de la démocratie. » Sur le site d’ATD-QuartMonde.
- Jean-Yves Séradin s’interroge comme tout le monde, car l’acte de lire reste mystérieux et complexe : « Comment les enfants passent-ils de l’oralité native à l’ordre graphique ? Il faut admettre que « l’interface entre l’oral et l’écrit reste une question complexe. » (Jack Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, La Dispute, 2013, p. 33) L’histoire plusieurs fois millénaire de la lecture – vers 4000 ans avant notre ère l’homme a appris à écrire – invite à la modestie, tout en attisant l’imaginaire pédagogique. »
***
Un exemple de fluence : une page de syllabes à lire à haute voix, très vite, avec chronomètre. L’élève a lu les 6 colonnes en 1 mn.
« Samah Karaki, neuroscientique, est très critique comme d’autres neuroscientifiques sur l’entrisme de quelques de leurs collègues qui veulent régenter la pédagogie Elle explique qu’ « on ne peut pas comprendre le trafic routier en ouvrant le capot des voitures, ni le vol des oiseaux en analysant leurs plumes : c’est pareil pour les comportements humains ». » En éducation, la neuroscientifique promeut avec raison le croisement des disciplines, en travaillant avec des sociologues et des anthropologues. » Dans Le Monde du 25 mars 2024.
***
Eveline Charmeux et Nadine Lanneau sont toutes deux membres du Collectif national La Riposte Education.
Nous sommes partenaires du Café pédagogique qui sur notre sujet a publié un mois après le débat, un article sur l’apprentissage de la lecture et ce qu’il en reste chez un trop grand nombre de jeunes de 16 à 18 ans lorsqu’on les évalue avec des tests de compréhension en lecture. L’accent est bien mis sur la compréhension ce qui est évident, sinon à quoi bon lire ?
« Bilan de la Journée Défense et Citoyenneté
En 2024, 843 500 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont participé à la la Journée Défense et Citoyenneté, au cours de laquelle un test de lecture est proposé.
Si 76 % des participants affichent un bon niveau,
13 % ont une compréhension très faible des textes,
et 6 % sont en situation d’illettrisme, selon les critères de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).
Ceux qui présentent les plus grandes difficultés disposent généralement d’un vocabulaire oral suffisant, mais sont incapables de comprendre un texte écrit. Les lecteurs dits « médiocres », quant à eux, montrent des lacunes – parfois importantes – dans les composantes fondamentales de la lecture (déchiffrage, automatisation, fluence), mais parviennent à compenser partiellement ces manques pour accéder à un certain niveau de compréhension. »
« Les chiffres dans les territoires d’Outre-mer sont alarmants : à Mayotte, plus d’un sur deux est en situation d’illettrisme. »
Nota bene : le déchiffrage, l’automatisation, la fluence cités ci-dessus, sont les critères actuels des évaluations en lecture.
Lire l’article du Café Pédagogique du 16 octobre 2025.
***
Exposition de livres à la médiathèque : on peut les emprunter
***